Bienvenue dans le n°19 « Entre les langues : le festival Focus Allemagne » de la revue Pariser Platz
Du 18 au 22 novembre 2024, rejoignez-nous à l’université Sorbonne Nouvelle, campus Nation, et à la Maison Heinrich Heine (entre autres lieux), pour le festival Focus-Allemagne, auquel ce numéro de Pariser Platz est en grande partie consacré.
En cliquant sur les vignettes des événements ci-dessous (ateliers, rencontres littéraires et artistiques, conférences, concerts, expositions, projections de films, performances…), vous trouverez des capsules présentant les différents événements sous forme de vidéos, photos, textes, interviews… Laissez-vous inspirer !
Toute la semaine


Du lundi 18 au vendredi 22
Lundi 18





Mardi 19
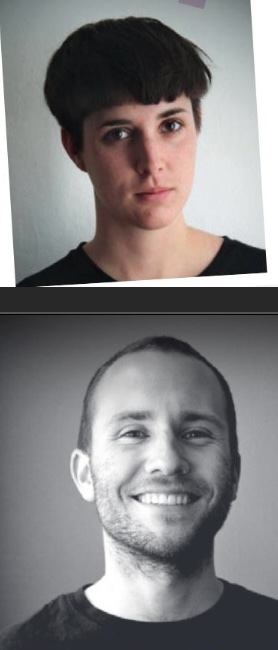

Mardi 19
à 14h

Mardi 19
à 16h


Mardi 19
à 18h


Mardi 19 à 19h

Mercredi 20
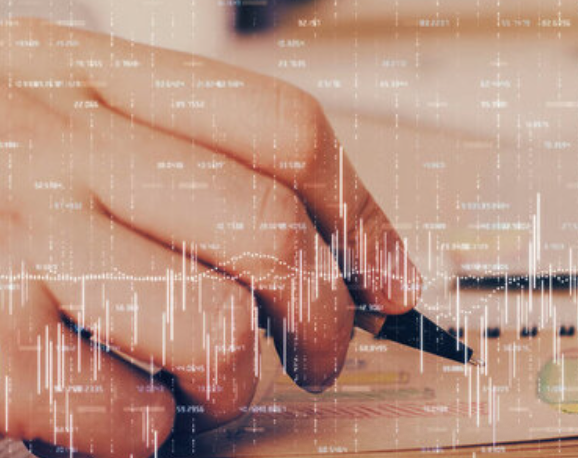



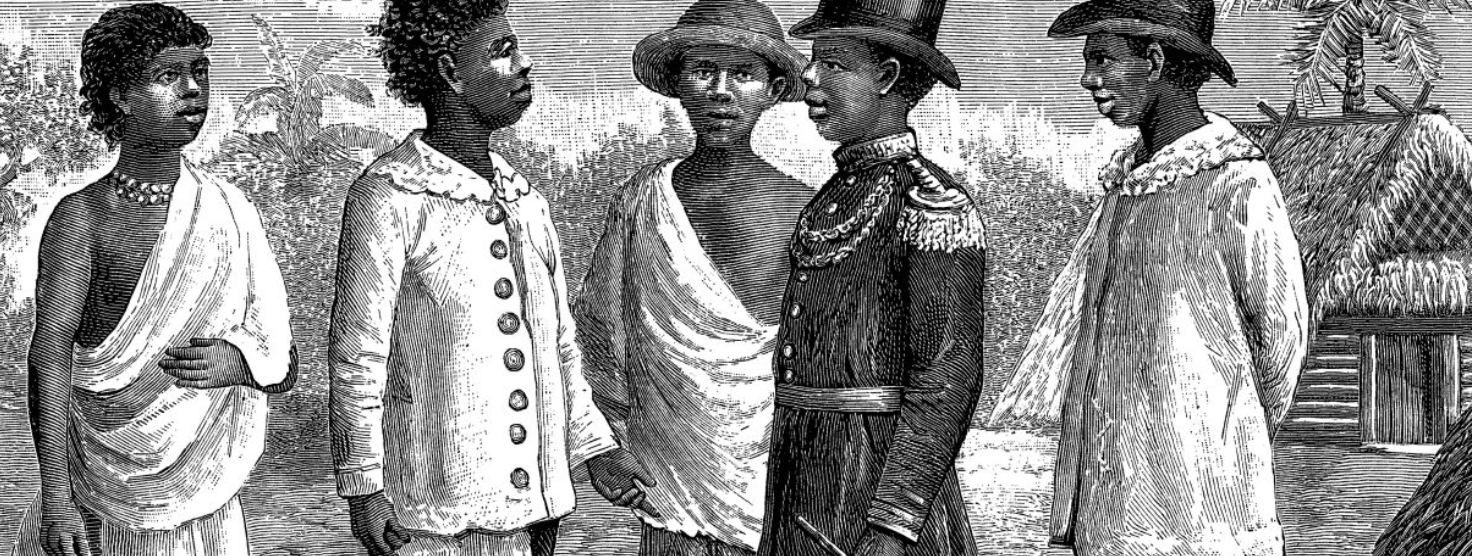
Jeudi 21

Jeudi 21 à 14h



Jeudi 21 à 16h

Jeudi 21 à 18h


Vendredi 22

Vendredi 22 à 9h30





Le festival est ouvert à tous : lycéens, étudiants, enseignants-chercheurs, artistes et autres curieux, germanophones & germanophiles. N’hésitez plus, en suivant les instructions du programme de la semaine FOCUS, à vous inscrire aux différents événements dont certains ont un nombre de places limité.
Ce projet est porté par le Service Arts et Cultures en collaboration avec le Département d’études germaniques et franco-allemandes, et avec le soutien de l’OFAJ, de l’Université franco-allemande, du DAAD, de la CVEC, du Goethe-Institut, de la Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine, et du CEREG.






